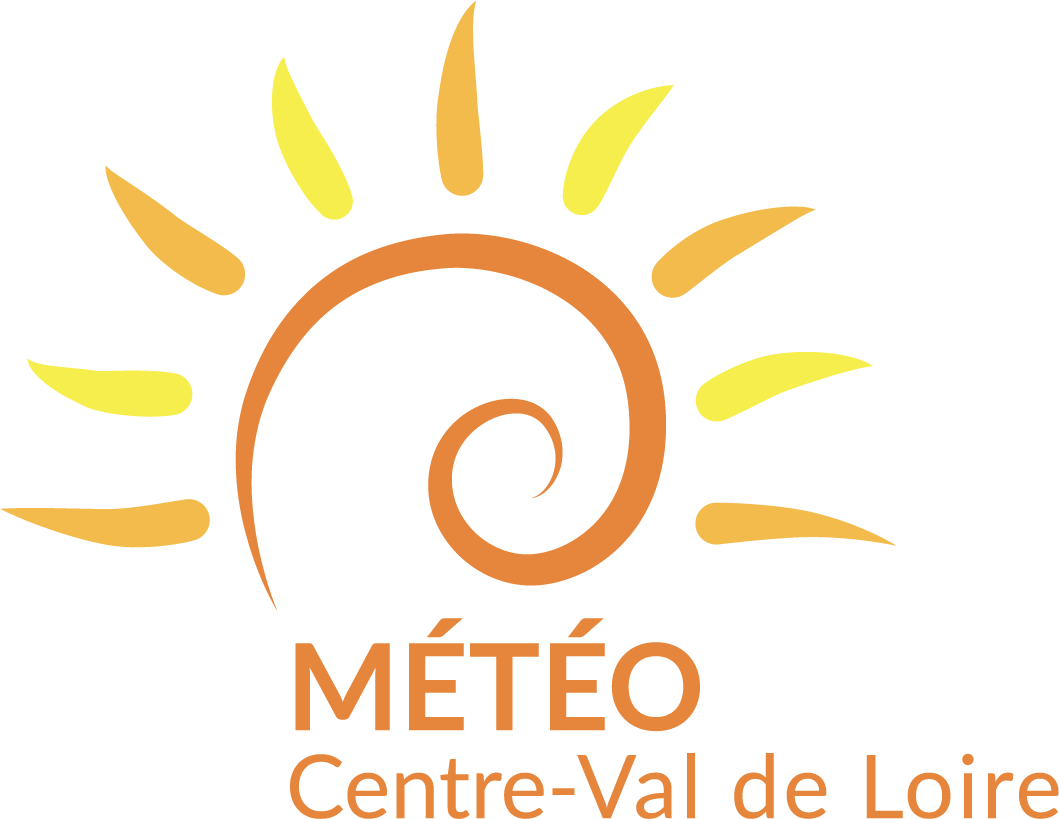Souvenez-vous ! Entre les 26 et 28 décembre 1999, deux tempêtes exceptionnelles ont frappé la France et nos régions centrales : Lothar au Nord, Martin au Sud. Retour en images et explications sur cet événement historique…

Fin décembre 1999, un contexte météorologique propice à la formation des tempêtes en Europe de l’Ouest ?
Sous l’influence d’un vaste complexe dépressionnaire positionné entre le Groenland et le Nord de l’Europe, un courant océanique très perturbé dominait la France pour cette fin d’année 1999. Dans ce flux d’Ouest très rapide, une succession de perturbations pluvieuses et venteuses a balayé notre pays avec le passage de deux fameuses tempêtes, Lothar et Martin, entre les 26 et 28 décembre 1999.

Ces deux tempêtes ont profité d’un courant-jet (courant de vent à très haute altitude, vers 9000 mètres) extrêmement costaud avec des vents soufflant à plus de 400 km/h voire même 500 km/h selon certains relevés, ce qui est exceptionnel !!!

Qu’annonçait la météo à la télévision pour cette fin d’année 1999 ?
Dès le 23 décembre 1999, les modèles de Météo France entrevoyaient un risque de tempête pour le 26 décembre. La situation étant jugée assez préoccupante, des bulletins d’alerte annonçant des vents violents étaient alors diffusés vers les services de la Sécurité civile (procédure de l’époque).
Le 24 décembre 1999, Météo France annonçait des vents forts et de fortes vagues sur la Manche et près de l’arc Atlantique pour les jours à venir.
Le 25 décembre 1999, Météo France prévoyait bien une tempête sur le Nord de la France pour le 26 décembre 1999 avec jusqu’à 130/140 km/h sur le littoral et 100/110 km/h dans les terres. Quelques heures avant le passage de la première tempête, Lothar, les bulletins météo télévisés évoquaient des vents forts à violents sur une partie de la France mais ne parlaient en aucun cas d’une tempête d’une extrême violence !
Pour Martin, les services météorologiques et bulletins météo télévisés évoquaient également des vents forts à violents sur une partie de la France mais tout comme Lothar, la force des vents a été sous estimée…
Pourquoi la violence de ces deux tempêtes a-t-elle été mal anticipée ?
Pour Lothar, ce sont le caractère « explosif » de son développement couplé à un creusement rapide qui ont été mal appréhendés par les modèles météo. Par ailleurs, certaines données faisant état d’un courant-jet avec des vents de plus de 500 km/h étaient jugées « erronées » à l’époque. En effet, une telle valeur était plus que remarquable et extrêmement rare !
Pour Martin, le manque d’observations et le rejet des données du même type que Lothar (mauvaises analyses de la pression et de divers paramètres d’altitude) ont amené à une autre sous-estimation de la valeur des vents.
Lothar et Martin, deux tempêtes d’une intensité exceptionnelle ?
Profitant d’un flux océanique très perturbé, Lothar et Martin ont rapidement traversé la France à la vitesse de 100 km/h, témoignant du flux d’Ouest extrêmement rapide.
- Lothar :
Lothar s’est formée dans le courant de la soirée de Noël, le 25 décembre 1999. Elle s’est développée très rapidement avec un caractère « explosif » en se dirigeant droit sur la France. En fin de nuit du 25 au 26 décembre, elle a abordé le Nord Ouest de la France par la baie du Mont-Saint-Michel avec une pression inférieure à 970 hPa puis elle a traversé le Nord du pays dans la matinée du 26 décembre 1999 avec une pression proche de 960 hPa sur le Nord Est de la France. A la mi-journée, elle s’est décalée vers l’Europe Centrale.


La tempête Lothar a touché 56% du territoire et duré 22h d’après Météo France. On a mesuré jusqu’à 173 km/h à Saint-Brieuc (22) et Solenzara (2A) en France et 151 km/h à Orléans-Bricy (45) sur nos régions Centre-Val de Loire et Centrales.

Vous pouvez retrouver les excellentes archives de Météo France sur cette tempête Lothar ici.
- Martin :
Martin s’est formée au large de la Bretagne dans la matinée du 27 décembre 1999. Tout comme Lothar, elle s’est rapidement développée avec un caractère « explosif » et a abordé le Sud de la Bretagne en fin d’après-midi avec une pression de l’ordre de 965 hPa en son centre ! En soirée, elle a traversé le centre du pays. Dans le courant de la nuit du 27 au 28 décembre 1999, elle s’est progressivement comblée en se décalant vers l’Est. Entre la fin de nuit et la matinée du 28 décembre, en lien avec Martin, une autre dépression s’est formée dans le Golfe de Gênes et a donné de fortes rafales de vent en Corse.


La tempête Martin a touché 50% du territoire et duré 28h d’après Météo France. On a mesuré jusqu’à 198 km/h à la Pointe de Chassiron (17) en France et 137 km/h à Saint-Nicolas-des-Biefs (03-montagne bourbonnaise) et 126 km/h à Vichy (03) sur nos régions Centre-Val de Loire et Centrales.

Vous pouvez retrouver les excellentes archives de Météo France sur cette tempête Martin ici.
Lothar et Martin, deux tempêtes dévastatrices et meurtrières…
L’ensemble des 2 tempêtes (Lothar et Martin) a fait 140 victimes en Europe dont 92 en France. Ces sont des milliards d’euros de perte économique à elles-deux (foyers privés d’électricité, arbres déracinés, infrastructures routières et ferroviaires fragilisées, maisons endomagées, etc.). Rien qu’avec Lothar, ce sont près de 100 millions de mètres cubes de bois qui ont été abattus (entre 5 et 10 % de la forêt française).
Voici quelques extraits des journaux télévisés de l’époque en France et sur nos régions Centre-Val de Loire et Centrales :
- en France :
- en région Centre-Val de Loire :
- en région Bourgogne :
- en région Auvergne :
- en région Limousin :
Les tempêtes de 1999, un déclic pour mieux informer sur les risques météo ?
Après ces catastrophes naturelles, à la demande de l’Etat, Météo France a réfléchi sur la mise au point d’un dispositif d’alerte et d’anticipation des risques météorologiques. C’est ainsi qu’après quelques mois de réflexion, en 2001, la Vigilance météorologique a vu le jour afin d’améliorer l’information des populations.
Pour les 20 ans de cet événement majeur, Météo France a reconstruit les cartes de vigilance qui auraient été produites si les tempêtes de 1999 se produisaient aujourd’hui :
- pour Lothar, 46 départements auraient été placés en Vigilance rouge (dont le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Nièvre et l’Yonne sur nos régions centrales) et 19 en Vigilance orange (dont l’Allier sur nos régions centrales)

- pour Martin, 35 départements (dont l’Allier et l’Indre sur nos régions centrales) et l’Andorre auraient été placés en rouge, 16 en orange (dont le Cher, l’Indre-et-Loire et la Nièvre sur nos régions centrales)

Pour savoir comment a évolué le dispositif de Vigilance de Météo France depuis le début des années 2000, n’hésitez pas à consulter le lien suivant : « Tempêtes de 1999 : naissance et évolution du dispositif de Vigilance« .
Les tempêtes de 1999 auraient elles pu être mieux appréhendées, si elles se produisaient aujourd’hui ?
D’après Météo France, « l’amélioration continue de nos modèles de prévisions numériques du temps, soutenue par la recherche et par l’augmentation considérable de la puissance de calcul, permettrait aujourd’hui d’obtenir 36 heures d’anticipation sur la prévision de l’arrivée de Lothar. Avec un système de prévision numérique proche de notre savoir-faire d’aujourd’hui, la prévision pour le 26/12 à 06 UTC, heure à laquelle la dépression a déjà atteint son stade de maturité sur la France, réalisée à partir du 23 décembre à 18 h UTC est de même qualité que la prévision réalisée à l’époque le 25 décembre à 06 h UTC. »
Pour savoir comment Météo France a géré les prévisions des tempêtes en 1999, n’hésitez pas à consulter les liens suivants :
- « Et si les tempêtes de 1999 se produisaient aujourd’hui ?«
- « Tempête de 1999 : « J’ai suivi Martin comme cheffe prévisionniste à Météo-France »«
Retrouvez également ce documentaire tourné au début des années 2000 :
Si de telles tempêtes venaient à se reproduire ces prochains mois ou futures années, nous serions donc mieux préparés dans la gestion de l’information des risques météo et de la diffusion auprès du grand public.
Enfin notre Association Météo Centre, créée en 2011 par Olivier Renard et composée uniquement de bénévoles, sert de complément à Météo France, dans le but de faire remonter toutes observations pertinentes et primordiales pour améliorer et faire évoluer les prévisions et mieux anticiper les risques météorologiques. Le développement de notre réseau de stations Météo Centre est aussi l’une de nos priorités afin de mieux quadriller notre territoire et mieux comprendre les phénomènes météo sur nos régions Centre-Val de Loire et Centrales. Nous jouons également un rôle de sensibilisation auprès de tous les publics afin de développer une culture du risque notamment vis à vis du changement climatique.